
Mohamed Ali : Le verbe et l’uppercut
Texte initialement paru dans Libération du 8 août 2019.
Son nom sonnait comme trois syllabes confondues «kas-us-klé» ! J’avais 10 ans et j’entendais les copains – «c’est moi Cassius Clay !» comme une garantie de victoire. Choisir son nom, c’était gagner, alors, ça rouspétait sévère dans la rue, «non, c’est moi, non ! moi !» et point d’autres noms de substitution. On était lui ou personne. Quand je me suis à mon tour approprié ce nom magique, je ne connaissais pas son visage, je n’avais pas encore la télé, c’était du mimétisme. Je m’identifiais à cette espèce de dieu invisible sans en connaître les traits. «Cassius», ça sonnait extraterrestre, divinité romaine, ça n’avait pas dans ma tête de consonance ethnique particulière, Clay relevait du super-héros de bande dessinée.
Comme il n’existait pas dans ma cité de jours sans coups, sans narine éclatée ou bosses, il était là présent pour rajouter du courage au muscle et les uppercuts trouaient l’air. Nous étions à cette époque les petits indigènes d’un pays blanc. Les occasions ne manquaient pas de vouloir casser des bouches, nous nous assumions barbares et idiots mais invincibles à la «chicore». L’adversité se levait tous les matins à nos côtés et en guise de cartable on se saisissait du bouclier Clay.
Puis un jour, il est apparu pour le combat du siècle, j’avais 12 ans, on annonçait le combat de tous les combats, et la rumeur gloussait une fin du monde, le début d’un autre où nous n’aurions plus peur des Blancs, plus peur de leur terrible domination, c’était sa promesse. Mon père disait en kabyle : «Il va l’éparpiller ce fils de chienne !» En vérité, il ne parlait pas de George Foreman mais du «petit Français» raciste qui lui pourrissait la vie car pour lui n’importe quel adversaire d’Ali était blanc, raciste et français même s’il était noir. Cet homme nous faisait haïr ses adversaires à des points culminants. A la fin du match, il les enlaçait, dix ans après, on continuait à les maudire. Liston, Frazier, Foreman, au pilori !
Combattre Ali, c’était revêtir l’habit de la disgrâce éternelle, on était le méchant et comme une inguérissable contagion notre descendance en prenait pour son grade. Mais ce que j’aimais surtout, c’est qu’il faisait sourire mon père par ses grimaces ahurissantes et ses embardées foutraques. Il montrait le Blanc du doigt, c’était bon.
«Tarzan est blanc, Jésus est blanc, le père Noël aussi, Miss Monde est blanche, la Voie est lactée, basta !» En fustigeant la société blanche, il détendait nos vieux, c’était fou, et j’aimais que cet homme mette du baume au cœur de mon père. D’autres héros, tels Nasser ou Arafat, galvanisaient les troupes. Ali faisait aussi rire, il était plus vaste que le fumeux droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, droits auxquels ils n’ont jamais eu droit. Il était clown et bourreau, à la fois gentil et cruel, blanc et noir, une apologie de l’universel. Pour ne pas céder à son charisme, il fallait la constance têtue du roi des ânes. Mon père me disait «regarde !» et j’étais content de partager avec lui un même héros. Cassius me liait à mon père par uppercuts interposés, nous faisait briller la pupille au même moment et pour les mêmes raisons, voilà sa force.
En 1974, ce fut le combat du siècle et ça se passait au Zaïre donc pour nous en Algérie, et nos cervelles ont éclaté de ce renversement de l’ordre du monde. Pour nous, c’était revenir à la source du mal, on ramenait le méchant colonisateur dans le lieu de l’infamie en le tirant par l’oreille, à l’endroit de tous les massacres pour l’agenouiller devant chaque tombe. Il réglait les comptes de tous les damnés de la terre. C’est là que je l’ai vu pour la première fois avec sa bouille de bambin et ses yeux exorbités. ll gesticulait, faisait tournoyer de longs bras en ailes de moulins. Tout autour de lui une foule hilare buvait ses paroles comme devant un prophète de la bonne humeur, elle semblait attendre la salve verbale plus que le coup. J’en restais sans voix d’une telle maîtrise de la langue, et ce fut le coup de foudre. Il redorait nos blasons par le verbe et l’uppercut.
J’ai ce souvenir d’un grand bavard, d’une insatiable boîte à paroles car cet homme se battait sur deux rings à la fois, celui de la boxe et plus important encore celui du combat pour réhabiliter son africanité. Jamais le mot «blanc» fut usité sous autant de configurations syntaxiques ou grammaticales et avec autant de subtilités langagières, de fougue ou de fourberie sans doute. C’était pour moi un véritable délice de voir nos oppresseurs battus sur le terrain de la rhétorique et du second degré, un délice de se jeter sous ce déluge qui nous lavait des innombrables insultes qui balisaient notre quotidien.
Pourtant, chose surréaliste, jamais société blanche n’a autant porté aux nues un athlète de couleur noire, envoûtée qu’elle était par la perspicacité de son verbe, la subtilité du sarcasme. Par son infernale diatribe, il inspirait davantage l’admiration que la peur. C’est ça : c’était le méchant qui ne faisait pas peur, le gros doudou des plus petits. J’ai admiré cet homme car s’il a été un des plus grands champions tous sports confondus, ce n’est pas le ring qui l’a fait icône mais la faconde.
On l’aurait aisément imaginé diplômé de lettres modernes ou carrément major de khâgne, la poétique en plus. Devenir roi des poings et prince de la métaphore n’est pas donné à tout un chacun. Qui mieux que lui a donné ses lettres de noblesse au calembour hargneux, à l’hyperbole sanglante ? Qui mieux que lui a su imager l’injustice dans ce qu’elle revêt de plus indigne ? Qui mieux que lui a su incarner la vitesse et la force, l’odieux et le sublime, tout et son contraire ? Che de la boxe, il a su être spirituel dans le sport le plus animal, un exploit.
Mais comme une volonté des dieux de le ramener vers de plus humbles caractéristiques, il a aussi fait part du plus étroit esprit, nous a purgés de la vanne la plus médiocre et de la plus détestable vanité, je n’oublie pas cela. Il a été imbu de lui-même comme personne au point de se faire couronner roi chez les plus grands dictateurs.
Mais voilà j’ai aimé ce côté indomptable, aimé cet homme sans classe sociale, sans race car les Blancs l’ont peut-être plus adulé que les Noirs, les classes aisées l’ont chéri, les parias porté aux nues. Il a su déchirer les codes à quelques bords qu’ils appartiennent, et s’il s’est fait musulman, c’est finalement pour davantage renaître d’aucune cendre que par une aveugle adhésion à la religion de Mahomet. En se rebaptisant, il est né de lui-même comme si rien n’avait existé avant, ni ancêtre, ni dieu, ni hasard. Il aurait pu être bonze, marabout ou athée s’il eut rencontré un Sartre de couleur et tout ça dans l’unique désir d’exister plus intensément que les autres. Un dieu vous dis-je mais rigolo, en connaissez-vous d’autres ?
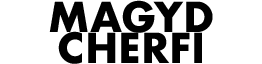

Aucun commentaire